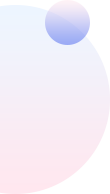L’urbanisme durable au cœur des Vaites : concevoir un quartier vivant et résilient
L’urbanisme durable repose sur une approche qui prend en compte l’environnement, l'économie et le social. Ces trois piliers indissociables forment la base d'une organisation urbaine respectueuse des ressources naturelles et des besoins humains. Préserver les ressources...
Lire +