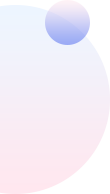Les solutions pour désimperméabiliser la ville
1. Intégrer des revêtements perméables
L’une des solutions les plus immédiates et accessibles consiste à remplacer les revêtements imperméables par des matériaux drainants. Les pavés perméables, les dalles alvéolées ou encore l’asphalte poreux permettent aux eaux pluviales de s’infiltrer directement dans le sol. En plus de réduire les risques d’inondations, ces alternatives participent à la recharge des nappes phréatiques.
Un exemple marquant ? La ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, a intégré des pavés perméables dans ses infrastructures pour faire face aux précipitations abondantes qui accompagnent le dérèglement climatique. Résultat : amélioration constatée de la rétention d’eau et diminution des coûts liés à l’entretien des infrastructures d’évacuation.
2. Créer des espaces verts multifonctionnels
Les espaces verts ne sont pas uniquement esthétiques : ils régénèrent les sols et optimisent la gestion des eaux. Par exemple, implanter des jardins de pluie, des bassins de rétention végétalisés ou encore des zones humides urbaines peut absorber des volumes importants d’eau tout en favorisant une biodiversité locale.
À Besançon, certains aménagements récents dans les parcs publics ont intégré des fosses végétalisées destinées à canaliser les pluies torrentielles. Ces installations sont un bel exemple de collaborations possibles entre planification urbaine et nature.
3. Encourager l’agriculture et les jardins urbains
Le développement de jardins partagés ou d'initiatives comme l’agriculture urbaine joue un rôle énorme. Ces espaces remplacent les zones bétonnées et redonnent vie aux sols tout en sensibilisant les habitants à l’importance de leur territoire. Ces lieux participatifs rapprochent également les citoyens des processus naturels, tout en améliorant leur qualité de vie.
Une solution intéressante est portée par Detroit (États-Unis), une ville longtemps marquée par la désindustrialisation : plus de 20 000 m2 de friches ont été convertis en zones agricoles urbaines, dont une mention spéciale pour les « urban farms », véritables exploitations agricoles miniatures offrant des produits locaux aux habitants.