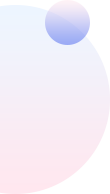Comment intégrer la nature au cœur de l’urbanisme ?
Introduire les principes de la nature en ville nécessite de repenser en profondeur certaines logiques urbanistiques, mais aussi d’expérimenter des solutions innovantes. Voici quelques pistes concrètes de mise en œuvre.
1. Multiplier les espaces verts accessibles
La création de parcs et jardins publics est l’un des moyens les plus visibles et appréciés d’intégrer la nature. Mais au-delà des grands espaces, il est aussi essentiel de penser aux petits lieux : squares de quartier, corridors verts, toits végétalisés…
L’idée ? Rendre la nature accessible au plus grand nombre, en garantissant qu’un espace vert se trouve à moins de 300 mètres de chaque habitant. Ce critère, proposé par l’Union internationale pour la conservation de la nature, est encore loin d’être atteint dans nombre de villes françaises.
2. Encourager l’agriculture urbaine
Les villes peuvent être des espaces de production alimentaire, en plus d’être des lieux de consommation. Les fermes urbaines, jardins partagés ou encore potagers collectifs sur les toits permettent non seulement de reconnecter les citadins à la terre, mais aussi de réduire les distances alimentaires et, par conséquent, l’empreinte carbone.
À Paris, par exemple, un projet ambitieux intitulé Parisculteurs vise à végétaliser et cultiver 100 hectares d'espaces urbains d’ici 2030. Une initiative prometteuse qui pourrait inspirer d’autres métropoles.
3. Protéger et restaurer la biodiversité
La ville est aussi un habitat en soi. Abeilles, oiseaux et même certains mammifères y cohabitent avec les humains. Pour favoriser cette biodiversité, il est possible de végétaliser les façades, installer des nichoirs ou préserver les zones humides autour des agglomérations.
Une inspiration notable : Singapour, surnommée la "ville jardin", a transformé ses espaces bétonnés en véritables écrins pour le vivant, accueillant des centaines d'espèces d'insectes et d'oiseaux. Tout cela grâce à une politique ambitieuse d'écoconstruction intégrant végétation, bassins et toits verts.
4. Penser la mobilité douce en lien avec la nature
Les mobilités douces, telles que le vélo ou la marche, peuvent elles aussi être intimement liées à la nature. Le développement de pistes cyclables ombragées ou de cheminements piétons parmi des alignements d’arbres permet à la fois de favoriser les déplacements non motorisés et d’améliorer le confort des usagers.
- Créer des corridors verts reliant différents quartiers pour encourager les trajets à pied ou à vélo.
- Aménager des "routes sans voitures" où la priorité est donnée aux mobilités durables.